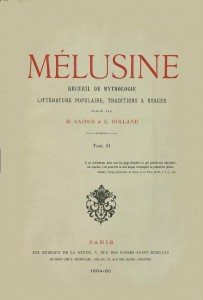Les Saint-Maixentais n’ont point laissé sans réponse les brocards décochés par leurs voisins ; un humble apothicaire s’est fait (vers 1660) le champion de sa ville natale, il a eu de plus le rare mérite d’écrire en vers Poitevins. Sans rien sacrifier à la forme, Jean Drouhet relate avec une recherche méticuleuse des termes et des locutions populaires les facéties attribuées à Niort, Poitiers ou Fontenay en représailles de celles dont on gratifiait Saint-Maixent. Il en est qu’on ne raconte plus, mais ce dont il faut surtout le glorifier, c’est de nous les rendre toutes avec leur originalité native et quelque peu rabelaisienne.
Les Saint-Maixentais n’ont point laissé sans réponse les brocards décochés par leurs voisins ; un humble apothicaire s’est fait (vers 1660) le champion de sa ville natale, il a eu de plus le rare mérite d’écrire en vers Poitevins. Sans rien sacrifier à la forme, Jean Drouhet relate avec une recherche méticuleuse des termes et des locutions populaires les facéties attribuées à Niort, Poitiers ou Fontenay en représailles de celles dont on gratifiait Saint-Maixent. Il en est qu’on ne raconte plus, mais ce dont il faut surtout le glorifier, c’est de nous les rendre toutes avec leur originalité native et quelque peu rabelaisienne.
Offrons tout d’abord, à ceux que n’effraie point cette âpre senteur du terroir, le groupe des Moiries injustement dédaigné par l’auteur des Saint-Maixentiades publiées dans le journal Le Français (1) et puisque les enfons de Sen-Moixont sont si chatouilleux, empruntons à l’un d’entre eux le récit de ces burlesques aventures municipales, nous ne saurions mieux interpréter les vers de Drouhet d’une intelligence difficile même pour ses contemporains.
« Les échevins de Poitiers, si l’on en croit la légende, après avoir vidé de nombreux flacons, parcouraient pendant toute la nuit les rues de la ville au grand galop de leurs chevaux, accompagnés de valets portant des torches. Ils allaient ensuite fourrer leur tête dans le trou d’une lanterne autour de laquelle se tenaient les bourgeois, et celui qui le garnissait au plus juste remportait le prix.
« A Niort, on s’en remettait au choix d’un baudet qui, après s’être bien repu d’avoine, venait devant l’un d’eux faire sa moue.
« A Fontenay, la palme était dévolue à celui qui après avoir bien couru dans la prairie pour en chasser les oies et les canards avalait le plus de petits pâtés.
« A Saint-Maixent enfin, les échevins se rendaient sous un prunier dont on secouait les branches et celui qui attrapait avec sa bouche l’un des fruits avant qu’il n’eût touché terre, était proclamé maire (2). »
Il fallait cracher le noyau ; il était arrivé qu’un échevin n’avait pu subir cette contre-épreuve ayant atteint par inadvertance le renvoi d’un dindon perché sur l’arbre. Cette année-là tout allait de mal en pis ; au second essai ce fut un cochon qui croqua la prune ; dans cette circonstance difficile le docte aréopage décida pour en finir que l’échevin le plus rapproché de l’animal serait choisi pour maire.
Quelque typiques que semblent ces Moiries, il est bien évident que nos ancêtres ne firent point grand effort pour les inventer. Ce n’est point chez nous que Victor Hugo est allé chercher la fameuse grimace de Quasimodo, elle est bien réellement une réminiscence d’un divertissement populaire, joyeux prélude, à Poitiers comme ailleurs, du choix du roi des fous.
Aux foires de Niort, les ânes savants ne s’y prennent point autrement que leur municipal ancêtre pour désigner le plus aimable, le plus amoureux, la plus belle etc. de la société.
L’élection de certain roi des gourmands rappelle, trait pour trait, l’épreuve subie par le futur maire de Fontenay.
J’ai vu enfin en Belgique des individus des deux sexes, il est vrai, s’efforcer de retenir avec leurs dents des brioches balancées au bout d’une corde, et leurs vains efforts me reportaient involontairement aux tentatives si souvent infructueuses des échevins Saint-Maixentais pour croquer la prune (3).
Ne croyez point que Drouhet n’ait à renvoyer à ses voisins rien que les histoires de leurs propres mairies.
Si les Niortais reprochaient aux gens de Saint-Maixent d’être gainés et de porter de gros sabots (4), il avait à répondre qu’eux-mêmes étaient toujours enroués grâce à l’humidité de leurs marais, inconvénient qui les obligeait de recourir à la puissante voix de ses compatriotes chaque fois qu’il fallait crier vive le roi. Il prouvait enfin dans la défonse des enfons de la ville de Sen-Moixont contre les railleries do gens de Poetey que les siens étaient tout aussi instruits et tout aussi policés que les habitants des autres cités de la province.
Il est pourtant une circonstance fort atténuante pour le prétendu béotisme Saint-Maixentais que Drouhet a toujours ignorée, c’est l’attribution à d’autres villes de la plupart des balourdises trop généreusement accordées jusqu’ici à sa cité natale. Il suffit de parcourir le Blason populaire de la France que viennent de nous donner MM. H. Gaidoz et P. Sébillot pour en avoir la preuve (5). Il fallait aussi que les railleurs fussent bien à court pour gratifier le pont de Croutelle (6) d’une inscription analogue (7) à celle qu’ils disaient lire sur la porte Châlon à Saint-Maixent : Cette porte a été faite ici.
Les histoires qui suivent se retrouvent encore ailleurs, quoique assez peu connues :
— Un habitant de St-Maixent eut l’ingénieuse idée de semer un boisseau de sel pour faire la nique aux gabelous l’année suivante. A la moisson il vint voir si le sel était bon à couper, mais ne voyant rien qu’une sauterelle bondissant sur le terrain nu, il pensa qu’elle avait tout mangé. Ne pouvant atteindre la maudite bête, il prie un chasseur de l’accompagner le lendemain avec son fusil. A leur arrivée clans le champ la sauterelle lui saute à la gorge il crie à son compagnon de tirer en lui montrant l’insecte, le coup part et naturellement tue la bête et l’homme ou plus exactement la sauterelle et le sautereau comme ne manque pas de le dire le narrateur.
— Des gens de St-Maixent allant à Niort voient clans un clos, près de la ville, de superbes citrouilles. Ils demandent au jardinier (8) ce que cela peut bien être, on leur répond que ce sont des œufs de mules. Etonnés à bien juste titre, ils les achètent et les emportent pour les faire couver. Fatigués au retour, ils déposent leurs potirons près d’un talus pour se reposer. L’un d’eux roule sur la pente et fait débouler un lièvre qu’ils prennent pour un petit mulet à cause de ses longues oreilles.
— Voici un exploit qui se passe en temps de guerre. Un bourgeois, fort inquiet, s’est endormi au soleil en surveillant ses vendangeurs. Tout à coup un bruit confus le réveille, ce sont trois bourdons entrés dans une gourde dont ils ne peuvent sortir. Notre homme saute à cheval et détale au plus vite croyant entendre le son du tambour. Pelotonné sous son lit sans avoir pris le temps d’ôter ses bottes, il croit sentir des épées qui lui pénètrent clans les chairs, ne pensant pas aux éperons de ses houzeaux trop près de son derrière. Sa femme arrive enfin et le tire de cette position ridicule (9).
— Un homme de St-Maixent part un jour sur son âne pour aller voir une tante qui habitait une localité voisine où il n’était jamais allé. Chemin faisant, un besoin l’oblige à mettre pied à terre et l’âne fait volte-face pendant qu’il a le clos tourné. Remonté sur sa bête, notre voyageur revient vers St-Maixent tout en croyant continuer sa route. Bientôt il arrive près de la ville et s’ébahit en voyant combien le pays diffère peu de celui où il est né. A mesure qu’il approche, les rues, les maisons mêmes semblent toutes pareilles ; bien plus les gens de chez sa tante sont faits comme les gens de St-Maixent, la porte enfin où l’âne s’arrête est identique à la sienne. Il frappe croyant avoir atteint le but de son voyage et est bien étonné de retrouver sa femme et ses enfants.
Enfin, dans l’article du Français, l’arrêté municipal relatif à l’herbe des promenades ne saurait être qu’une réminiscence d’une lettre « confidentielle et personnelle », écrite sous le second Empire par un maire de Coulonges-sur-l’Autise (Deux-Sèvres) à son garde-champêtre, divulguée clans un procès célèbre et qui sert depuis lors à l’ébaudissement des journalistes. Il s’agissait dans l’espèce de gens bien ou mal pensants dont les poules pourraient se trouver en contravention et qu’il fallait poursuivre ou non suivant le barème de leurs opinions politiques ; toujours comme ci-devant, cette récente bourde tend à passer aux gens de Saint-Maixent ; décidément on ne prête jamais qu’aux riches !
Les pots de moutarde (10), le clocher qui pousse grâce à l’affaissement du fumier, le cadran recouvert d’une caisse en bois, quelques joyeusetés de la porte Chalon dont l’une a été reproduite à propos de la pompe à incendie, voilà donc à peu près tout ce que les Poitevins auraient trouvé de neuf pour en glorifier Saint-Maixent si l’on en jugeait par les nombreux écrits qui traitent de ces graves matières. Pourtant l’enquête générale n’est qu’à peine commencée et l’on trouve bien encore par ailleurs la mention, un peu sommaire, il est vrai, d’un autre cadran (11). Cherchons encore et revenons à la porte Chalon, aussi bien peut-être ne savez-vous pas pourquoi elle est toujours ouverte (12).
— A une époque peu reculée, on songea enfin à paver la rue Chalon. Un dos d’âne s’éleva au-dessous de la célèbre porte qu’on fut bien étonné de ne pouvoir plus refermer le soir. Le Conseil municipal s’assemble en hâte et ne trouve d’autre remède que d’enlever la barrière, ce qui fut fait le lendemain. Depuis ce temps rien ne clôt plus la principale entrée de la ville et la porte Chalon est devenue une porte sans porte.
Voilà, penserez-vous, une belle invention, au moins n’a-t-elle encore rien de sinistre, celle qui suit n’est pas d’une gaîté folle. Il s’agit d’un pendu à qui on met une belle chemise blanche pour cacher sa nudité quand le roi vient à passer. Elle se trouve dans les Bons mots et joyeusetés des pendus (13) ; Jean Hiroux eut, paraît-il, des précurseurs.
Du pendu au juge il n’y a pas loin. Un quidam avait deux affaires le même jour au tribunal de Saint-Maixent. L’une lui semblait mauvaise ce fut pourtant la seule qu’il gagna. Comme il se récriait hautement, le juge se hâta de lui répondre: « Ah! Monsieur, ce n’est pas à Saint-Maixent qu’on gagne deux procès en un jour. »
Passons aux badauderies de fraîche date.
— Un vieux Saint-Maixentais se plaignait à sa femme de ce que les gamins lui volaient toujours son mouchoir pendant les offices. Celle-ci décida de le lui coudre au fond de la poche pour le dimanche suivant et comme les petits drôles tiraient encore, le bonhomme se mit à dire : « vous ne l’aurez pas aujourd’hui, ma femme l’a cousu. »
— Une sentinelle, placée à la porte Chalon pendant la chouannerie, s’écria en voyant arriver une bande d’individus armés : « ne tirez-pas, il y a du monde. »
— Un charlatan de Saint-Maixent disait qu’il savait sept langues mais qu’il les parlait en Français pour la commodité de ses auditeurs.
— Les gens de Saint-Maixent désirant recevoir le préfet avec toutes les pompes possibles vinrent au-devant de lui avec toutes les pompes de la ville qu’ils firent jouer en sa présence.
— Quand Napoléon 1er passa à Saint-Maixent, le maire lui déclara qu’il n’avait pas tiré le canon pour 21 raisons et se mit en devoir de les énumérer. Comme la première était qu’il n’en avait pas, l’empereur daigna le dispenser des autres.
— En 1815, après le retour des Bourbons, le préfet envoyé pour l’installation du nouveau maire, fut reçu dans la cour de l’ancien château déjà transformé en dépôt d’étalons. On remarqua que la musique des pompiers jouait avec beaucoup d’entrain à l’arrivée du préfet, l’air : « Où peut-on être mieux qu’au sein de sa famille. »
Je passe et pour cause, la sanglante plaisanterie imaginée à propos du passage de Napoléon III, alors Président de la République (14), pour arriver à une jocrissade assez récente qui n’est peut-être pas cependant la dernière, car rien ne prouve, comme on l’a dit fort justement (15), que la source soit tarie.
— La pose des fils télégraphiques avait amené un grand concours d’habitants désireux d’assister à cette curieuse opération. Des paysans intrigués s’approchèrent à leur tour pour demander à un citadin de quoi il s’agissait. « C’est, dit-il, en se rengorgeant, un moulin à vent qu’on est en train de construire. » — Ah ! Monsieur, répondit l’autre, alors ça ne m’étonne pas de voir déjà les ânes autour.
Il y a, comme vous le voyez, une balourdise pour chaque évènement. Ces joyeusetés monumentent les fastes de la petite cité Poitevine, ce sont ses Marmora Oxonica.
N’allez pas croire cependant que les Saint-Maixentais n’aient jamais eu le dernier mot depuis Jean Drouhet ; une anecdote, recueillie par Jouyneau-Desloges, vous prouverait le contraire (16).
« On sait combien la ville de Saint-Maixent est célèbre pour sa moutarde. Un voyageur s’y étant arrêté il y a quelques jours pour dîner, étonné de ce qu’on ne lui en servait pas, en demanda ; l’aubergiste répond qu’il n’en a pas dans ce moment ; j’en veux absolument, dit l’étranger, qu’on m’en cherche. On court chez tous les faiseurs ; point de moutarde ; le voyageur, qui était un plaisant, va chez un notaire, après son repas, et lui demande acte comme, dans une pareille saison, Saint-Maixent se trouvoit sans moutarde. Le notaire vit bien qu’on voulait le jouer et répandre du ridicule sur sa ville ; cependant il se promit intérieurement de se venger du plaisant ; il dresse l’acte, après être sorti un moment de son cabinet sous quelque prétexte, et avoir envoyé un huissier à l’auberge saisir le cheval et les équipages du voyageur ; on signe l’acte, le notaire dit qu’il va en faire l’expédition ; l’étranger sort, et à son retour à l’auberge est bien étonné de trouver son cheval et ses équipages saisis. Il revient chez le notaire qui convient qu’il était l’auteur de la saisie pour la sûreté de ses droits, parce qu’il ne le connaissoit pas, que cet acte étoit assez cher et qu’il ne donnerait main levée qu’en recevant un louis. Le voyageur, pressé d’ailleurs de continuer sa route, insista peu, parce qu’il vit qu’il étoit joué à son tour, comme il méritoit. Il donne le louis, reçoit la main levée de ses effets et part. On rit beaucoup aux dépens du voyageur et le louis fut envoyé à l’hôpital. »
Sous le gouvernement de Juillet, une singulière méprise du docteur Giraudeau de Saint-Gervais, auteur d’un Précis historique du Poitou (17), a aussi égayé les Saint-Maixentais. On y trouve ce qui suit :
« Saint-Maixent est situé sur le bord de la mer, à 10 lieues de Poitiers, sur la route de la Rochelle et à 15 lieues de cette ville. »
En Poitou, on dit de toute localité déplaisante : « c’est un joli port de mer ». Saint-Maixent, cela va sans dire, ne pouvait y échapper.
Le docte spécialiste a accepté, sans inventaire, cette facétie pour une réalité et voilà comment par un trait de plume, notre ville s’est trouvée tout à coup transportée sur les bords de l’Océan.
Vous voyez qu’il en cuit parfois de prendre trop à la lettre les billevesées dont on accable nos excellents voisins.
Jean Drouhet, nous l’avons dit, attribuait volontiers aux Niortais toutes ces malices, ailleurs réparties sur une foule de localités et accumulées en Poitou sur sa ville natale ; mais avait-il bien lieu de le faire, n’étaient-elles pas plutôt l’apport des marchands qui accouraient à nos grandes foires de tous les coins de la France !
Niort n’avait guère moins à se défendre, prendre le chemin de Niort (18), était une injure inventée par les argotiers à la suite des trafiquants ; c’étaient là ces sages qu’un proverbe de même origine, convie à se rendre chez nous (19) pour couper les bourses. N’oublions pas la réputation de laideur faite aux filles de Niort (20).
N’avons-nous pas vu qu’on disait à Saint-Maixent même que nos ancêtres étaient toujours enroués grâce au voisinage des marais et que pour crier vive le roi, il leur fallait emprunter l’assistance de leurs voisins (21) ?
Léo DESAIVRE.
Notes Saint-Maixentaises
« Le correspondant de Mélusine (col. 377) en ses Saint-Maixentiades a commis quelques erreurs et oublis qu’il est nécessaire de relever.
ART. : POT DE MOUTARDE. — Le roi était Henri IV, le pot de moutarde un baril en argent finement ciselé. Au bout de quelques temps, l’enthousiasme s’étant refroidi, le conseil de ville regretta ses dépenses et avisa un moyen de rentrer dans ses frais. Il écrivit alors au roi.
— « Sire, si vous avez trouvé la moutarde bonne, renvoyez le baril ! » Ils espéraient ainsi amorcer Sa Majesté et le baril une fois revenu, ne plus le renvoyer. Mais Henri IV, plus malin qu’eux, garda le baril, se disant sans doute :
Un tiens vaut mieux que deux tu l’auras.
ART. : PONT. — Ce n’est point d’un pont dont on dit à Saint-Maixent qu’il a été « fait ici. »
Voici le fait :
Il existe à Saint-Maixent, reliant la ville et un faubourg, appelé faubourg Châlons, une porte monumentale, sorte d’arc de triomphe, dont les Saint-Maixentais sont très fiers. On l’appelle la Porte Châlons. C’est d’elle dont on dit : Cette porte a été faite ici.
Mais il est nécessaire de donner une explication qui excuse dans une certaine mesure la naïveté proverbiale de nos voisins.
En patois poitevin : « Thiau lou » signifie : « Ici. » —
Les paysans, par suite de la ressemblance des mots Chalons et Thiau lou, appelèrent ladite porte : la Porte de Thiau lou, la porte d’ici. Et quelque facétieux dut dans la suite inventer l’histoire de la porte « faite ici » (22).
ART. : BANCS POUR S’ASSEOIR ! Aggravation ! — (Entendu de mes oreilles).
Un jour on plaisantait un Saint-Maixentais devant moi, sur les « bancs pour s’asseoir. » — C’est une calomnie, dit notre homme indigné, à Saint-Maixent il n’y a jamais eu de bancs pour s’asseoir !
UN POITEVIN.
(1) Voir plus haut col. 377.
(2) Les œuvres de Jean Drouhet rééditées par Alfred Richard archiviste de la Vienne. Poitiers E. Druineaud, 1878, la Moirie de Sen-Moixont o lez vervedé de tretoute lez autres p. 15-16.
La 1re éd. est de 1661.
(3) [De même à Paris, dans les fêtes foraines, on voit des industriels, surtout ceux qui tiennent une loterie de pains d'épice, amorcer leur public en promenant autour d'eux une ligne appâtée d'un dé en pain d'épice que les enfants doivent happer avec la bouche, sans l'intervention des mains. — H. G.]
(4) Malhabillés. A. Richard L. C. 24 de la Fontenelle de Vaudoré Journal des Le Riche. (Requête des habitants de Saint-Maixent à l’intendant Moreau de Beaumont) en patois poitevin, p. 529.
(5) Paris, Léopold Cerf, 1884. Voir plus haut, col. 165.
(6) Ancien relai sur la route de Bordeaux, tout près de Poitiers.
(7) Ce pont a été fait ici. V. de Chergé, Guide du voyageur à Poitiers et aux environs, p. 344.
(8) La ville de Niort est entourée de cultures maraîchères.
(9) Voir plus haut, col. 357, n° 1.
(10) Quoi qu’on en dise, la fabrication de la moutarde à Saint-Maixent date de plusieurs siècles.
(11) Blason populaire, 188.
(12) Chalon est un nom d’homme et nullement celui d’une ville.
(13) Paris 1734, cité par Alfred Richard ; j’omets à dessein le curé de Saint-Maixent qui n’a qu’un œil et 4 dents et qui hausse bien le gobelet, etc. de la gente poitevin’rie.
(14) [En octobre 1851, L. N. passa par Saint-Maixent au retour de son Voyage du Midi. On lui avait, dit la légende, préparé une agréable surprise. A son entrée dans la ville, un manteau impérial et une couronne devaient descendre du haut de la porte
Chalon. Or voici ce qui serait arrivé. Le manteau et la couronne tombèrent à terre, il ne resta plus d'un truc si ingénieux qu'un écriteau portant : « Il l'aura pendu au bout d'une corde. La foule n'en saluait pas moins de ses acclamations enthousiastes. Note de la Rédaction).
(15) Gaidoz et Sébillot, Blason populaire, p. 258.
(16) Affiches du Poitou, 1775 n° 8, p. 35.
(17) Paris, Dussillion, p. 77.
(18) C.-à-d. nier.
(19) A Niort qui veut aller.
Faut qu'il soit sage à parler, Blason pop., 257.
(20) C'est la fille de Niort malheureuse en beauté.
(21) Voir plus haut.
(22) [Nous insérons cette explication pour montrer la tendance populaire à expliquer les légendes par des étymologies qui ont une apparence de raison — Red.]
Source du document : H. Gaidoz & E. Rolland – Mélusine – Recueil de Mythologie, littérature populaire, traditions & usages – Tome 2 – Paris 1884, 1885